Dans cet article, qui devrait être le prélude à un travail plus conséquent, je reviendrai rapidement sur ce que sont les partis politiques et ce qui les rend nécessaires, les raisons pour lesquelles cette forme organisationnelle peut paraître dépassée, la nature de la France Insoumise et ce qui peut à mon avis permettre de construire une force politique à gauche en position de permettre la prise de pouvoir aux classes dominées de la société. Le but de cette première ébauche est de confronter les connaissances données par la sociologie politique à la réflexion stratégique à gauche.
L'origine et la fonction des partis politiques
En effet, les partis politiques deviennent nécessaires avec l'apparition du suffrage universel dans le cadre de régimes parlementaires : dans un système où il existe des élections libres auxquelles tous les citoyens adultes ont le droit de vote, les dirigeants politiques ont besoin d'organisations à leur service qui incitent les électeurs à s'inscrire sur les listes électorales et à voter pour eux, ils ne peuvent pas se contenter de la notoriété et des réseaux de clientèle qui pouvaient suffire à leur élection à l'époque du suffrage censitaire, le corps électoral étant beaucoup plus important. C'est de ce principe que partait Maurice Duverger lorsqu'il présentait les origines de ses deux idéaux-types de partis politiques (Les Partis politiques) : les uns créés par des réseaux de notables autour d'eux pour assurer leur élection, et par conséquent peu disciplinés puisqu'ils regroupent des acteurs ayant une forte indépendance grâce à leurs ressources, les partis de cadres (ce qui est le cas de la plupart des partis bourgeois de la IIIème République) ; les autres créés par des mouvements au sein de la société civile voulant prendre le pouvoir pour faire aboutir leurs revendications, ceux-là plus disciplinés puisque créés par des acteurs qui n'ont pas de ressources en politique autre que celles fournies par leurs partis, et structurés de façon pyramidale, les adhérents de base désignant leurs chefs -ce sont les partis de masse, qui, faute de notables, reposent avant tout sur leur nombre d'adhérents (ce qui est généralement le cas des partis issus du mouvement ouvrier). Bien sûr, on observe rarement le type pur de ces deux catégories, d'autant que les partis politiques ont beaucoup évolué depuis : les partis bourgeois ont cherché à constituer des organisations plus massives et disciplinées pour s'adapter à la concurrence des partis de masse (on peut par exemple penser aux partis gaullistes, pour lesquels d'autres politistes ont inventé de nouvelles catégories, ou aux partis fascistes pour lesquels Duverger parlait de partis-milices), tandis que les partis de masse ont fait émerger une couche de professionnels de la politique qui ont obtenu suffisamment de ressources pour devenir à leur tour des notables.
Quoi qu'il en soit, cela nous permet de nous rendre compte qu'avoir une organisation massive et disciplinée représente historiquement un atout pour les organisations du mouvement ouvrier afin de compenser les positions dominantes occupées par ses adversaires de classe ; telle est l'origine des partis de gauche fortement structurés du XXème siècle, dont le PCF des années 30 aux années 70 représente le meilleur exemple en France, proche de ce qu'était la sociale-démocratie allemande avant la première guerre mondiale.
Partis politiques et conscience de classe
Cette idée était d'une manière générale répandue au sein des partis sociaux-démocrates, on la trouve notamment théorisée dans Que faire ? de Lénine où le futur chef de la fraction bolchévique du parti social-démocrate russe expliquait la nécessité d'une organisation distincte de la classe qu'était le prolétariat, regroupant ses éléments conscients et organisée par une couche de révolutionnaires professionnels, devant amener le prolétariat dans son ensemble à la révolution. Plus tard, Lénine a relativisé ce texte qui donnait un trop grand rôle au parti politique et avait été écrit pour un parti illégal, ce qui doit être pris en compte pour comprendre ses développements sur la démocratie interne et la transparence, plus tard sortis de leur contexte par Staline. On trouve une vision laissant davantage de place à l'autonomie des masses, sans nier le rôle du parti, chez Rosa Luxemburg dans Question d'organisation de la sociale-démocratie russe (où elle répondait aux arguments présentés par Lénine dans Un pas en avant, deux pas en arrière, récapitulant sa polémique avec les menchéviques) : un parti centralisé est nécessaire pour arracher le pouvoir à une bourgeoisie qui fonctionne elle-même de manière centralisée, certes, toutefois le parti ne peut pas être soumis à une direction composée de révolutionnaires professionnels car cette direction, ayant à préserver son appareil, risque de se montrer trop conservatrice au moment d'engager la lutte et de se couper des masses ; a contrario, les masses n'apprendront pas le socialisme dans les livres et la propagande du parti, elles ont besoin de faire concrètement l'expérience de prendre les décisions elles-mêmes pour apprendre à s'émanciper, leur discipline doit être une soumission à un fonctionnement démocratique, contrairement à la soumission aux capitalistes que les prolétaires connaissent dans leur travail, et elles doivent faire leurs propres erreurs pour trouver le chemin vers la révolution. L'évolution du Parti bolchévique lui-même a à vrai dire donné raison à Rosa Luxemburg : après la révolution de février 1917, celui-ci a en effet adopté sous l'impulsion de Staline et Kamenev une position de soutien au gouvernement provisoire bourgeois et de rapprochement avec les menchéviques, à rebours des ouvriers représentés dans les soviets qui faisaient au contraire directement l'expérience des limites d'une révolution bourgeoise et se mettaient donc à espérer le renversement du gouvernement provisoire ; seul le retour de Lénine a permis de le faire changer de position grâce à ses Thèses d'avril. Enfin, s'inspirant principalement de Lénine, le communiste italien Antonio Gramsci a élaboré sa célèbre théorie du parti comme intellectuel collectif devant fédérer autour de son programme un bloc historique constitué des "catégories subalternes" (les catégories dominées au-delà du seul prolétariat) et mener une "guerre de positions" dans l'État et la société civile d'un pays en vue de préparer le moment où éclaterait une crise révolutionnaire, situation dans laquelle il faudrait au contraire chercher à s'emparer du pouvoir en suivant la radicalisation des masses, la "guerre de mouvements".
Toutes ces conceptions ont donc en commun l'idée que l'organisation partisane permet d'apprendre au prolétariat comment mettre fin à son exploitation, que ce soit en lui donnant des cadres connaissant la théorie révolutionnaires, en fournissant aux masses un cadre où apprendre à exercer le pouvoir ou en unissant les intérêts de catégories sociales différentes par une construction intellectuelle. Cette idée est confirmée par la sociologie politique : dans Le Cens caché, Daniel Gaxie montre ainsi que si l'appartenance à une organisation a peu d'effet sur le niveau d'intérêt pour la politique et de compétence politique des catégories sociales ayant un fort capital culturel, elle est en revanche décisive pour les classes populaires, dont les membres manifestent un plus fort intérêt pour la politique, savent mieux s'y repérer suivant des critères proprement politiques et se sentent plus légitimes à exprimer des opinions politiques lorsqu'ils sont membres d'organisations, qu'il s'agisse de partis ou de syndicats. Encore une fois, le parti permet donc de compenser les inégalités subies par les classes dominées. Sans surprise, Daniel Gaxie notait alors que ses enquêtés votaient davantage en fonction de leurs intérêts de classe lorsqu'ils étaient membres d'une organisation.
Une crise des partis politiques ?
Les sociétés changent, en effet : la désindustrialisation implique la destruction des sociabilités basées sur les fortes concentrations d'ouvriers, qui formaient la base des partis de masse socialistes du XXème siècle ; le militantisme perd beaucoup de son intérêt avec le niveau de développement des médias actuels, par lesquels les dirigeants politiques communiquent avec les électeurs directement, par le biais de la télévision, de la radio ou d'internet, sans nécessairement avoir besoin de passer par leurs militants et une presse partisane, de leur côté les militants perdent la primeur des informations ; enfin, internet donne également la possibilité de militer à des gens qui n'ont pas les moyens d'un parti politique derrière eux mais qui parviennent à se construire une notoriété sur les réseaux sociaux, ce qui ôte encore aux avantages d'être membre d'un parti politique comparés aux coûts, au risque cependant de ne toucher qu'un public déjà sensible à leurs idées.
On irait cependant vite en besogne si l'on en concluait que les partis politiques sont en crise, a fortiori qu'ils seraient voués à disparaître : ce sont toujours eux qui dominent les élections, les acteurs indépendants n'y ont généralement aucune chance, d'autant plus que le coût financier des campagnes s'est beaucoup élevé sous la Vème République ; ils remplissent toujours leur fonction d'organiser le suffrage universel, mais ils le font avec moins d'adhérents et de militantisme. Ce n'est pas un problème pour les principaux partis bourgeois, qui ont suffisamment de ressources financières et médiatiques pour se passer d'une base militante forte, au point qu'ils finissent par devenir davantage dépendants de l'État que de leurs adhérents, c'est l'analyse de la "cartellisation des partis politiques" présentée par les politistes américains Richard Katz et Peter Mair ; en revanche, c'en est un pour les partis socialistes qui, représentant les dominés, ont moins de ressources financières, moins accès aux médias, et ont besoin d'un cadre organisationnel pour former leurs militants afin de s'implanter dans les classes populaires.
La nature de la France Insoumise
Les problèmes que cela pose ont été très largement dénoncés par les adversaires de la FI ainsi que par des adhérents et des cadres en rupture avec elle. Néanmoins, avant de les aborder, on doit constater que cela fonctionne dans un cadre précis : celui de l'élection présidentielle. Partant d'une base faible (le Parti de Gauche revendiquait huit mille adhérents à la création de la FI), Jean-Luc Mélenchon a en effet réussi à atteindre 19,58% des voix en 2017 puis 21,95% en 2022. C'est donc que la forme de la FI est adaptée dans le cadre d'une élection présidentielle de nos jours : dans cette situation de très forte politisation due à son importance dans l'élection présidentielle et à l'attention médiatique qui lui est portée, la possibilité de commencer à militer en se contentant de s'inscrire à un site internet et de créer un groupe local sans avoir à s'accorder avec un échelon supérieur a en effet permis un engagement militant massif en abaissant les coûts de l'engagement politique et en privilégiant l'espace virtuel où les sociabilités s'établissent plus facilement dans notre société désindustrialisée.
En revanche, l'expérience sur la durée a surtout montré les limites de cette forme : déclin rapide du militantisme passée l'élection présidentielle, absence de structuration locale qui ne permet pas d'organisation efficace et cohérente aux élections locales, déconnexion des dirigeants due à l'absence totale non seulement de démocratie mais plus généralement de lien entre les militants et les dirigeants, manque d'ancrage dans les catégories populaires, même urbaines, dû à l'impossibilité d'y former des cadres faute d'échelon intermédiaire, absence d'une doctrine partagée au-delà du programme et donc manque de radicalité. S'il ne peut pas être question de ressusciter les partis tels qu'ils existaient autrefois dans la société actuelle, la forme du "mouvement gazeux" ne semble donc pas suffisante non plus pour permettre aux classes dominées de prendre le pouvoir, quand bien même elle pourrait remporter une élection présidentielle.
Quelle forme pour prendre le pouvoir au XXIème siècle ?
L'émergence d'une autre force politique à gauche parait difficilement possible compte tenu de la puissance actuelle de la FI dans les médias et au parlement alors qu'elle ne s'est pas discréditée dans un exercice du pouvoir national pour l'heure. Cela laisse donc deux possibilités dans le cadre de la France Insoumise : ou bien lui donner des adhérents, des structures locales et des instances représentatives tout en préservant la possibilité de créer des groupes locaux pour les non-adhérents, en sachant que les instances représentatives en question peuvent être plus diversifiées que ce que l'on a connu autrefois, par exemple en incluant des représentants d'organisations du mouvement social, ou en les séparant en plusieurs espaces se concertant ; ou bien un renforcement des partis politiques présents en son sein qui lui serviraient alors de structures, tels que le Parti de Gauche, le Parti Ouvrier Indépendant et diverses organisations trotskystes beaucoup plus petites (Révolution, Gauche révolutionnaire, Tendance CLAIRE qui participe par ailleurs également au NPA), ce qui présenterait l'avantage d'exprimer la diversité politique de la FI, néanmoins ces structures sont actuellement très faibles et peuvent difficilement sortir de cette faiblesse tant que les coûts que comporte l'engagement en leur sein (cotisation, dépendance à des prises de décision dans le cadre de structure locales et nationales) ne sont pas compensés par des avantages (participation aux décisions à l'échelle de la FI, possibilité d'être sélectionné comme représentant la FI à des élections).
Cela ne peut donc réussir sans évolution interne de la FI, ce qui n'est pas voulu à l'heure actuelle par les dirigeants de celle-ci. À ce titre, les partis présents dans la FI auraient un intérêt commun à revendiquer ensemble un changement, soit pour une structuration de la FI en tant que telle, soit pour bénéficier d'un rôle officiel dans la formation et les prises de position de la FI, quitte à partager ce rôle avec d'autres acteurs comme ceux issus du mouvement social.



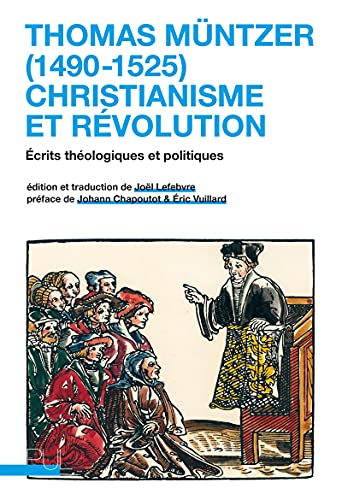

 Flux RSS
Flux RSS
